« L’attaque » par une trentaine de personnes masquées (Vincent Larouche, journal La Presse, 29 mai 2016) sur un commerce rue Notre-Dame dans le quartier Saint-Henri a fait du boucan auprès des médias. . Ce n’est pas la première fois (ni la dernière) qu’un tel type d’événement se produit. On peut logiquement supposer qu’avec l’aggravation continue des conséquences de l’embourgeoisement sur les conditions de vie d’une partie importante des populations locales dans les quartiers subissant l’embourgeoisement, de telles actions d’éclat risquent de perdurer et même de se durcir.
Ce n’est pas la première fois (ni la dernière) qu’un tel type d’événement se produit. On peut logiquement supposer qu’avec l’aggravation continue des conséquences de l’embourgeoisement sur les conditions de vie d’une partie importante des populations locales dans les quartiers subissant l’embourgeoisement, de telles actions d’éclat risquent de perdurer et même de se durcir.
Cette attaque-réaction que l’on doit qualifier de politique et de militante n’est pas dénuée de cohérence quoique qu’en disent les médias, politiciens-nes ou autres citoyens outrés qui tentent de décrire ces militant-e-s comme de simples vandales, des cons ou des fauteurs de trouble. On évite alors volontairement d’aborder les enjeux de fond liés à l’embourgeoisement des quartiers. Quant aux commerçants visés par ces actions, ils n’arrivent pas à comprendre, ou ne cherchent pas c’est selon, ce qui se passe. Avouons qu’il peut être difficile de déchiffrer le lien entre l’attaque d’un commerce de produits fins en alimentation et le système « organisé » de l’embourgeoisement.
Les tracts militants et graffitis laissés sur les lieux ne font pas de doute. À moins de vouloir sciemment l’ignorer, le message est clairement politique même si dans ce genre de tracts, courts par nécessité, l’analyse y apparaît plutôt faible. Sans faire une analyse exhaustive, quelques éléments clés peuvent nous faire comprendre la réaction de jeunes militant-e-s face à l’envahissement de leur milieu de vie.
Le bout de la chaîne
L’épicerie fine qui a été assaillie à St-Henri représente en quelque sorte le bout de la chaîne du processus d’embourgeoisement. Elle est en même temps un des symboles visibles d’une nouvelle sorte de « re-colonisation » du territoire urbain qui, sur une période plus ou moins longue, évince les ménages à faible et moyen revenu (populations non solvables) des quartiers. Lorsque les nouvelles populations mieux nanties économiquement s’installent dans ces vieux quartiers en voie de transformation on voit alors apparaître les nouveaux commerces offrant des produits et des lieux de consommation directement connectés aux demandes de ces nouveaux résidents. Avec la transformation de la trame commerciale, on assiste alors au bouclage de ce que sera à terme la nouvelle image du quartier, débarrassé de sa population pauvre.
L’embourgeoisement des quartiers centraux des villes est relativement connu et documenté. Depuis le début des années 1990, le phénomène d’embourgeoisement, y compris à Montréal, s’est toutefois accéléré et étendu à l’échelle des villes du monde. Les nombreux répertoires et classements des villes où dit-on « il fait bon vivre » et qu’on nous cite régulièrement dans les médias sont le reflet de ce visage et de la vitrine que se donne la mondialisation capitaliste. Économiquement, on mise à grande échelle sur le tourisme de masse, l’industrie culturelle et spectaculaire, la recherche des sièges sociaux et leur cohorte de « managers » ultra payée, etc. Bref, tout ce qui peut faire circuler le maximum de fric par des populations capables de payer sur un territoire concentré autour des centres-villes, là où (ça tombe bien) les services publics y sont les plus développés et où on peut y accéder facilement en transport actif (vélo, marche, transport en commun).
Pour donner corps à cette image recherchée de ville internationale, il faut remplacer les populations à faible revenu et autres marginaux qui peuplent encore les vieux quartiers par des nouvelles populations qui pourront rentabiliser les investissements colossaux nécessaires. C’est à travers la réhabilitation et la rénovation des centres-villes et des vieux quartiers industriels que l’embourgeoisement se déploie. Vieilles usines désaffectées où se sont installés 20 ans plus tôt des artistes et artisans plus ou moins sans le sou, terrains vacants résultants de démolitions, vieux logements ouvriers promus au titre de patrimoine, etc. sont l’objet d’activités spéculatives et immobilières soutenues par des modifications de zonage avantageuses, des programmes de subvention à la carte et du retapage des infrastructures publiques. Pour réussir, une telle opération doit compter sur une convergence d’intérêts économiques entre les pouvoirs politiques et économiques.
La sécurité urbaine
On ne l’avait pas oublié celle-là. En effet, pour mener à bien une telle opération il faut se débarrasser de tout ce qui gêne et pourraient causer des irritations(itinérants, quêteux, populations à faible revenu incapable de consommer, graffitis, collectifs de militant-e-s radicaux, etc.). Bref, tout ce qui n’est pas conforme à l’image aseptisée que l’on veut donner à la ville et à ses quartiers limitrophes. L’aspect sécuritaire devient alors hyper important et sans surprise il fait partie des critères incontournables du classement des « villes internationales ».
Voilà pourquoi dans les dernières années le ton s’est durci face à la résistance d’une partie des populations qui refusent d’être « dépossédées » et chassées de leur territoire. On traque non seulement les incivilités dites communes (systèmes de caméras un peu partout – intégrés même dans les nouveaux complexes d’habitation-), mais on s’attaque désormais avec plus de détermination aux résistances politiques. Par exemple dans nombre de villes européennes (Berlin, Munich, Amsterdam, Barcelone, Athènes, Paris, etc.) les pouvoirs tentent de déloger les squats militants qui « menacent » dit-on la paix sociale. Cela provoque actuellement plus de perturbations compte tenu du niveau de résistance qui s’est accru. Ce sera la même chose à Montréal.
On le voit partout dans le monde dit démocratique, le phénomène de répression politique est en voie de militarisation accrue (durcissement des lois et des sentences à des militant-e-s politiques, démantèlement de camps de fortune de réfugiés, régression du droit d’expression, etc.). Montréal ne fait pas exception depuis le début des années 2000.
La mixité sociale, concept fourre-tout
À Montréal, c’est sous le prétexte de favoriser la « mixité sociale », qu’on insinue ouvertement (politiciens-nes, hauts fonctionnaires et même quelques promoteurs délurés) que les vieux quartiers populaires et ouvriers seraient des ghettos (lire des concentrations de pauvres) qui empêchent la ville de prospérer. À l’inverse on ne propose pas de mixité sociale à Westmount ville particulièrement homogène en haut de la pyramide socio-économique. Alors pour « rétablir » la soi-disant « mixité sociale » les responsables politiques, toutes tendances politiques confondues, ont favorisé et donné préséance aux promoteurs immobiliers. Les failles depuis longtemps connues de la réglementation sur la protection du « droit au logement » devenaient un atout supplémentaire pour qui voulait les contourner. Dans un tel contexte, la promotion de la mixité sociale veut dire mettre l’accent sur des ménages solvables (en mesure de consommer la production que propose le « Montréal international ») au détriment des non solvables. Bref, un changement majeur de population sur une période plus ou moins longue.
Ainsi, à titre d’exemple, la levée du zonage industriel vers le zonage résidentiel autour du canal de Lachine dans les quartiers du Sud-Ouest a fait bondir le coût des terrains. Ainsi, autour du nouveau quartier phare de Griffintown, voisin de St-Henri et de Pointe-Saint-Charles, la valeur des terrains et des logements a plus que triplé en l’espace de quelques mois. Si bien, que durant plusieurs années l’arrondissement Sud-Ouest a gagné le championnat des hausses d’évaluation foncière à Montréal, devançant même le célèbre Plateau Mont-Royal. Qu’arrive-t-il alors ? L’engouement pour le nouveau quartier à la mode entraînent dans les quartiers environnants l’augmentation faramineuse des loyers pour les locataires. Les vieux logements sont rachetés pour rénovation majeure et transformés en condo de luxe, les locataires expulsés. Lorsqu’il y a résistance, on contourne la réglementation ou on fait du harcèlement pour vider les lieux. Par exemple, dans Griffintown, la ville a dû acheter à prix d’or pour des dizaines de millions$ quelques terrains pour réaliser des espaces verts. On apprend qu’un petit parc pour enfants s’est réalisé au coût de 3.5 millions. Même des institutions publiques (école, santé) n’ont pu s’y implanter. Trop cher. On y voit se développer des écoles et des cliniques privées, la voie capitaliste de l’organisation sociale.
Parallèlement, les loyers commerciaux sont entraînés vers le haut. On anticipe déjà les profits, car cette nouvelle population réclame des services. Voilà les nouveaux commerçants qui arrivent prenant la place des anciens commerces eux-mêmes délogés par des nouveaux loyers inabordables. Pour rentabiliser leurs investissements, ils s’adressent inévitablement à la nouvelle clientèle capable de consommer des produits de grande qualité, souvent bio, mais chers. Ainsi cette nouvelle clientèle, nouveaux citoyens du quartier ou commerçants, sont pour une grande part, et au mieux, indifférents à leur environnement. Ils et elles n’ont pas conscience du milieu dans lequel ils et elles s’installent et surtout des drames que leur arrivée provoque. Ils et elles sont en quelque sorte la chair à canon inconsciente des forces politiques et économiques qui misent sur le système d’embourgeoisement.
Ainsi, l’embourgeoisement, phénomène où les forces politiques et économiques dominantes convergent autour du redéveloppement économique et de la « nouvelle » mixité sociale, devient dans le contexte actuel une « sorte de guerre de faible intensité » contre une partie significative des populations locales. On n’y voit pas les cadavres et les blessés s’accumuler dans les rues, mais cette guerre produit son lot de victimes (dépression, maladie, déracinement, perte de services sociaux, etc.) dans les couches sociales moins nanties. Mais ça on n’en parle pas. On choisit de se rattacher à la vision du Montréal international, cette image bucolique de la mondialisation capitaliste. Concurrence oblige.
Voici d’ailleurs, à titre d’exemple la vision que charrie les médias: un premier rapporté par la journaliste Danielle Bonneau du journal La Presse le 25 mai dernier concernant le promoteur immobilier Prével : « L’autre apport du promoteur, encore plus important à ses yeux, s’avère sa contribution au logement abordable. «On n’a pas eu à le convaincre que c’était une nécessité, précise-t-il. On a besoin de produits immobiliers différents et d’une mixité sociale. Depuis que je suis en poste, en 2009, ç’a toujours été facile de ce côté avec Prével.»
Pour les quatre phases du Lowney sur Ville, Prével versera 1 273 800 $ au fonds d’investissement de la Ville de Montréal pour la création de logements communautaires et sociaux. Pour les phases 8 à 11 du Lowney, il a cédé un terrain à l’angle des rues Wellington et Murray, d’une valeur de 900 000 $.
«C’est grâce à Jacques Vincent, de Prével, et Serge Goulet, de Devimco Immobilier, si Griffintown est devenu le quartier trendy qu’il est aujourd’hui, indique pour sa part Vincent Shirley, directeur, marché résidentiel chez Groupe Altus. Ils ont travaillé d’arrache-pied, avec le maire Dorais. Il y a 10 ans, on ne tapait pas Griffintown dans les moteurs de recherche. Il n’y avait rien!»
On y trouve les thèmes du logement abordable (on déteste parler de logement social dans le milieu), de la mixité sociale, de la « généreuse » contribution. En fait c’est 1696 logements, valeur de 400 millions$ pour .05% du total.
Et sur le qualificatif « Trenty » désignant les grands projets de Griffintown, le journal Le Devoir du 25 juin 2016, page 8, s’exprime ainsi :
« Une franche fortunée de Montréalais, principalement des célibataires, des jeunes retraités et des couples de professionnels sans enfant, les affectionnent, autant qu’un nombre de plus en plus croissant de propriétaires étrangers qui cherchent là un pied-à-terre prestigieux ou un bon placement.
Ils viennent de l’Égypte, du Qatar, d’ailleurs au Proche ou au Moyen-Orient, de la Floride, de l’Arizona, de Hong Kong. Ils ont la jeunesse estudiantine bien nantie, l’expatriation temporaire dans le domaine de la finance, de l’aéronautique, de la santé… Ils représentent un fonds de retraite, un groupe d’investisseurs. À l’image de la faune urbaine qui a posé ses pénates dans ce coin de la ville, ils cherchent dans le marbre d’un comptoir, dans l’assemblage des pierres, de vitres et vieux bois typiques de ces constructions neuves, l’expression d’une certaine modernité et d’un confort organisé ».
La coupe est pleine. C’est ce qu’on dû penser les jeunes militant-e-s devant une telle glorification affichée (pas seulement dans les journaux) des charmes de l’embourgeoisement.
Une opposition désarmée
Pour faire face à ce rouleau compresseur de l’embourgeoisement se trouve quelques élu-e-s municipaux socio-démocrates et disons-le, mal à l’aise. Leur discours tente de rallier deux antagonismes et créer l’équilibre entre les intérêts des uns et des autres alors que les moyens d’agir concrètement (multiplication du logement social entre autres) sont à peu près inexistants. D’une part, ils s’inscrivent dans la logique générale de l’accession à la propriété individuelle comme position politique générale (ce qui les empêche de prendre des positions claires contre le phénomène de l’embourgeoisement), mais leurs actions se résument à saupoudrer un peu de logement social pour tenter d’enrayer l’hécatombe. Il va sans dire, ils et elles ont très peu d’impact sur la trame de fond néo-libérale qui règne sur l’ensemble des politiques urbaines montréalaises. S’appuyant sur une stratégie d’inclusion du logement abordable (à Montréal) mis en place par un gouvernement municipal de droite et comme par hasard appuyé par le milieu des affaires, ils et elles sont littéralement menottées. Une véritable politique social-démocrate impliquerait des objectifs en fonction des besoins réels de la population et non en fonction des exigences du marché immobilier.
Quant aux organisations communautaires qui défendent le droit au logement et le logement social comme principal moyen de lutte à la pauvreté, elles ont assisté impuissantes à la dégradation des programmes destinés au logement social durant les 20 dernières années. Dans la foulée, et c’est là le drame, leur faible capacité de mobilisation et d’actions, essentiellement dirigée sur les pouvoirs politiques, n’a eu que peu d’effet. Si le discours s’est un peu radicalisé, les actions, elles, n’ont cependant pas dépassé le symbolisme (occupation de terrains, etc.) alors que la situation réelle de dépossession des territoires exigerait des moyens de résistance qui fasse reculer les pouvoirs politiques et économiques dominants. Bref, et l’opposition institutionnelle parlementaire et l’opposition militante communautaire ne font pas le poids face aux multiples manifestations de l’embourgeoisement.
C’est dans une telle conjoncture que dans les quartiers centraux, les tensions s’accumulent et les clivages s’accentuent. Le quartier de St-Henri, comme celui de Pointe-Saint-Charles, voisin de Griffitown, subissent de plein fouet le débordement de l’activité immobilière intense qui s’y mène depuis plus de 15 ans. C’est par centaines que des ménages ont dû quitter leur quartier.
Pour les couches sociales vulnérables (et ils sont des dizaines de milliers de ménages à Montréal) l’espoir d’un avenir meilleur est littéralement anéanti. Des groupes militants et de militantes radicales font aussi cette constatation. Certains décident de poser des gestes d’éclat (émaillé d’un peu de désespoir) comme celui d’envahir un commerce de produits alimentaires fins. En faisant ce geste les militant-e-s ne proposent certainement pas défendre les supermarchés locaux qui fournissent pour moins chers des produits de l’alimentation industrielle et bourrée de pesticides. Au fond, l’accessibilité à une alimentation saine et accessible pour tous et toutes est un des enjeux soulevés dans cette attaque. Voilà pourquoi ils et elles ont raflés les excellentes saucisses et fromages dans les comptoirs du commerce. S’il s’agit à première vue d’un geste de protestation, en fond de jardin se cache une intention de rupture vis-à-vis du système qui promeut l’embourgeoisement comme méthode de guerre de basse intensité contre les couches sociales défavorisées. Voilà pourquoi il s’agit d’un geste politique.
Pourquoi un commerce plutôt que de s’attaquer directement aux promoteurs immobiliers ? Sans doute, de façon pragmatique, était-ce moins risqué et aussi moins difficile à organiser, face à l’incontournable répression policière, que d’envahir des condos vides (puisqu’il faut plus d’organisation sur du plus long terme). Aujourd’hui dans plusieurs pays européens, où les conditions de vie sont semblables aux nôtres, les formes de résistance populaire et politique se sont radicalisées et elles s’en prennent aux promoteurs immobiliers et à ceux qui les financent (les banques).
Bien sûr nous préférerions que les actions visent directement les vrais fauteurs de trouble – les pouvoirs politiques et les promoteurs immobiliers. Ça serait « plus facile » pour les milieux militants de soulever les vrais enjeux politiques liés à l’embourgeoisement des quartiers.
D’ici à ce que le point de mire de la résistance se déplace, il y a tout lieu de croire qu’il y aura d’autres attaques sur des commerces identifiés à l’embourgeoisement des quartiers.
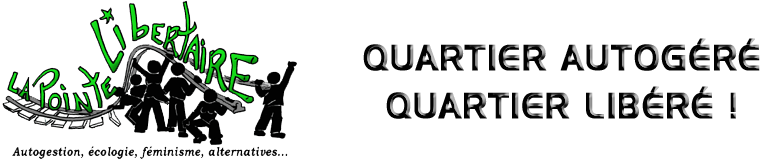










 href="http://archive.lapointelibertaire.org/node/1317.html">
href="http://archive.lapointelibertaire.org/node/1317.html">

