Après avoir toléré une « violente » manifestation (c’est-à-dire pour laquelle aucun trajet n’avait été communiqué et qui s’est soldé par un feu dans la rue…) de la part d’employé.e.s municipaux, les membres de la Fraternité des policiers de Montréal ont engagé des moyens de pression cette semaine pour dénoncer la façon dont le gouvernement s’y prend pour régler le problème des déficits des régimes de retraite municipaux. Le processus de « négociation » n’est pas encore terminé, bien sûr, mais personne n’est dupe; il est complètement bidon et les employé.e.s vont boire la tasse. Face à cette petite dose d’austérité, le président de la Fraternité, Yves Francoeur, monte aux barricades pour sauver la part policière du gâteau, et rien d’autre. Petite analyse.

La réaction de Francoeur est classique; c’est celle du corporatisme professionnel auquel on est habitué au Québec dans le milieu syndical, où la solidarité est une denrée au moins aussi rare qu’ailleurs. Le but y est, comme ailleurs, de protéger le contenu de son porte-feuille. Autrement dit, le syndicalisme québécois ne porte plus de projet de société; il a intégré les valeurs de la société capitaliste dans laquelle il prend maintenant racine, et s’y borne. On pourrait même dire qu’il s’y enterre, car cet abandon d’un projet social signe son arrêt de mort; sous les attaques constantes de la droite, le syndicalisme corporatiste, sans âme, ne peut plus se justifier et mobiliser une résistance populaire. Pourquoi se battre pour sauver la pension de quelqu’un qui ne nous aide pas quand on a des problèmes semblables, ou plus lourds…?
C’est le piège du morcellement dans lequel les différents gouvernements néolibéraux nous ont fait tomber: diviser pour régner. En présentant chaque situation sociale comme un privilège acquis aux dépens du reste de la société, la droite riche réussit à se mettre hors d’atteinte en tournant tous les groupes sociaux les uns contre les autres; assisté.e.s sociaux, étudiant.e.s, syndiqué.e.s, personnes âgées, et ainsi de suite, sont chacun.e leur tour présenté.e.s comme les ennemis parasitaires des « contribuables », terme flou qui ne représente au fond que tous ces gens mis ensembles. En 2012, c’était au tour des étudiant.e.s, aujourd’hui des employé.e.s municipaux. Demain, on voudra débrancher les aîné.e.s à l’hôpital. Malheureusement, la plupart des gens, en se sentant menacés, ont le réflexe de développer de l’hostilité envers les autres. C’est un réflexe de protection qu’on a vu souvent pendant la grève étudiante de 2012; mieux vaut les autres que moi. Si je réussis à me maintenir la tête au-dessus de l’eau, au-dessus des autres assez longtemps, le gouvernement n’aura pas à couper jusqu’à moi. Ainsi, on peut se demander si les jeunes se mobiliseront plus pour sauver leurs ainé.e.s délaissé.e.s à l’hôpital lorsque leur tour sera venu que ceux et celles-ci l’ont fait en 2012 pour leur permettre de rester à l’école…
Même l’article de Radio-Canada que je cite tombe dans le panneau, affirmant que « le régime de retraite des policiers est financé à 77 % par les contribuables ». Les « contribuables », c’est l’employeur, avec lequel la fraternité a négocié, financé « avec nos taxes », nul autre que l’État, qui gère ses fonds à sa guise. À en croire la Commission Charbonneau, ces fonds partent pourtant plus en fumée dans les poches de la mafia que dans celles des employé.e.s. Pire encore, les régimes de retraite sont en déficit à cause de la déconfiture financière de 2007-2008. Le gouvernement a déréglementé le secteur financier pour laisser les banques jouer au casino, et maintenant que tout ça leur a pété à la figure, il faudrait que ce soit la population qui paye? (La crise financière est assez complexe à comprendre, mais je recommande le documentaire Inside Job à quiconque voulant la preuve de ce que j’avance ici.) Car n’en déplaise aux Richard Martineau de ce monde, les syndiqué.e.s, étudiant.e.s ou autres font aussi partie de la population; ce sont des « contribuables ». J’ajouterais même, n’en déplaise à certain.e.s de mes camarades de la gauche radicale, que c’est aussi le cas des policiers et policières. Mais revenons à l’article de Radio-Canada; ignorance journalistique ou propagande malicieuse? Qu’importe. Ce qui est frappant d’ironie, c’est que les journalistes de Radio-Canada se battent présentement pour échapper aux coupures du gouvernement fédéral. Aucune solidarité là non plus.
Ainsi, Francoeur et ses membres, comme tout le monde, foncent pour sauver leurs fesses sur ce bateau néolibéral qui coule. Le calcul est vicieux, mais, de leur part, il n’est pas fou, la résistance policière ayant beaucoup plus de chances de réussir à sauver leur pension que les autres. Après tout, le gouvernement en aura toujours besoin pour écraser la résistance des autres groupes, quitte à crever quelques yeux. Mieux vaut pour les néolibéraux accepter de payer une bande, si elle peut leur permettre de vider les autres. Qui plus est, les manifestations policières ne seront pas encerclées sur le champ en raison du règlement P-6, ou même si elles mettent le feu sur la rue. Quand on peut choisir comment appliquer la loi…
Dans tous les cas, cette attitude n’en demeure pas moins une erreur fatale. L’idéologie policière leur permet peut-être de dormir le soir en sachant maintenir un niveau de vie élevé par le fait de contribuer au délabrement de la société, mais on ne peut pas vivre seul dans son coin, et tôt ou tard ce délabrement les affectera aussi. La raison en est que le manque d’argent qui justifie l’austérité néolibérale est créé par la structure actuelle du capitalisme; il manquera donc toujours d’argent, jusqu’à ce que la société change. Personne n’est à l’abri, et ce sera à notre tour d’y passer tôt ou tard (sauf si on fait partie du 1%, mais ce n’est quand même pas le cas de la police; avoir un bon salaire n’est pas être propriétaire de la société…). La solution se trouve plutôt dans la reconnaissance de ce que nous avons tous et toutes en commun, et de miser dessus par le développement d’une solidarité sincère et réelle.
Est-ce à dire que l’on devrait appuyer la Fraternité ou les journalistes de Radio-Canada dans leurs luttes? Bien sûr que non. Pour exister, la solidarité doit fonctionner « dans les deux sens », et l’initiative de cette circulation réside toujours du côté le plus privilégié. Et comme il existe toujours quelqu’un.e de « moins bien amanché.e » que nous, on peut toujours initier une relation de solidarité. Ainsi, à moins d’être mieux nanti.e que les policiers, policières ou journalistes, mieux vaut chercher ailleurs; comme le disait mon père, donne à manger à un cochon, il chie sur ton perron… Ces gens en profiteraient sans s’engager dans un lien réel et mutuel, comme ça a été le cas avec le syndicat des professeur.e.s de l’UQAM, qui a bénéficié de l’appui des associations étudiantes de l’Université lors de sa grève de 2009, mais qu’on n’a pas vu se mouiller pendant celles des étudiant.e.s de 2012.
À l’inverse, les journalistes pourraient cependant, par exemple, initier une telle relation en présentant un réel projet de démocratisation de leur média en opposition aux coupes, plutôt qu’un seul argumentaire pour sauver leurs fesses. C’est ce que proposait mon camarade Marcel Sévigny dans un article faisant la première page du Couac en juin 2014. Un tel projet miserait réellement sur le renforcement de la communauté et la solidarité qui doit nécessairement en être le ciment, non seulement de par sa nature même, mais aussi parce qu’il offrirait enfin un contre-poids médiatique à la propagande de droite qui sert à tourner les groupes visés par l’austérité les uns contre les autres. On pourrait alors décemment les soutenir dans une lutte, un peu comme pendant la grève de La Presse de 1971, qui visait, entre autres, à protéger la liberté journalistique face aux opinions des propriétaires de médias. D’ici à ce que les journalistes le comprennent, cependant… Une telle approche serait même possible avec la police, puisque ça s’est déjà produit dans l’histoire, notamment pendant la grève générale de Winnipeg en 1919. Les policiers avaient alors participé au mouvement, par solidarité autant que pour leurs propres conditions de travail, souvent au prix de leur emploi… On est cependant loin d’une telle situation à l’heure actuelle. Nous verrons bien si ces gens en viennent à en avoir assez de voir le bateau couler, ou s’ils ne comprendront jamais rien à rien.
Par Pascal Lebrun
Pour l’Agence de presse libre de Pointe-Saint-Charles.
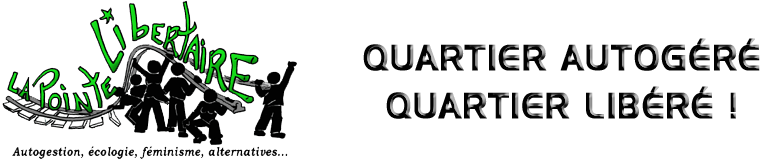










 href="http://archive.lapointelibertaire.org/node/1317.html">
href="http://archive.lapointelibertaire.org/node/1317.html">

